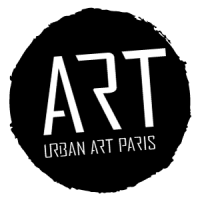ARTICLE 2 : La vision et l’analyse du mouvement graffiti par Tilt
Notre rencontre avec l’artiste Tilt nous a permis d’esquisser ses motivations, de mieux appréhender son style. Une patte singulière qui semble avoir évolué au cours des années de pratique, avec l’expérience et les rencontres. Nous allons maintenant tenter de comprendre et percevoir l’évolution du graffiti dans son ensemble, tout comme dans le travail de l’artiste toulousain.
Il y a finalement dans ton parcours un peu deux générations, c’est à l’image de l’évolution du graffiti ?
Même trois générations. La génération de “tu n’as pas d’autre choix quand tu fais du graffiti que de le faire de manière radicale.”
C’est avec l’arrivée du street art que les artistes ont eu le choix de quitter le graffiti traditionnel, pour aller dans la branche street art (galerie, argent, réussite, institutionnalisation, mur, etc.)
La troisième génération, c’est un peu le mélange des deux. C’est-à-dire que l’on reprend le graffiti de base traditionnel et c’est peut-être quelque part en réponse au street art mainstream.
Par exemple, quand je regarde sur Instagram et que je vois que dans le monde, il y a des mecs de 16, 18 et 20 ans qui se disent que : “le migrant avec les tee-shirts Suprême ça fait chier. Nous, on va faire du graffiti hardcore.” Et ben je suis content.
Cette nouvelle forme de graffiti va créer des styles un peu plus ignorants, crados. Ça va amener des graffeurs toulousains à peindre dans la rue un esthétisme un peu plus dur. Par exemple, sur le “périph”, à l’extincteur, sur l’autoroute alors qu’il y a les flics, etc.
“Personnellement, je pense que le graffiti se doit d’être une réponse radicale au street art”
Je trouve ça trop bien, on veut que ce soit cash, dur. En réponse au street art “chiant” consensuel et business. On peut dire qu’il y a eu les nouvelles générations de graffeurs qui y sont allés de manière encore plus hardcore que nous. Je trouve ça mortel, ils vont nous sauver !
Je fais souvent des parallèles avec la musique. C’est comme si à un concert de rap ou de punk, il n’y a que des places assises et le public est en costard. Là, l’artiste sur scène regarde son public et se dit “mais qu’est ce qui se passe les gars, qu’est ce qu’on a fait ? On a dû foirer ” (rires). Cela serait la même chose s’il ne restait que le street art.
C’est pour ça que mon travail artistique sur toile est hyper radical, il y a des coulures, des bouts de flops crados. Ce n’est pas du tout figuratif, mais il évoque le graffiti vandale.
Je fais des installations qui rappellent les squats. J’utilise des gros coups d’extincteurs pour rappeler aux gens que l’environnement du graffiti, ce n’est pas un atelier. Ce n’est pas JonOne qui peint dans son atelier. Je travaille sur ça, je montre le côté radical parce que ma pratique est devenue elle-même radicale. Je n’aime plus passer du temps à faire des beaux graffs.
Donc les valeurs associées à ce milieu semblent avoir évolué avec ce dernier, mais en quoi est-ce qu’elles semblent avoir changé ?
Autour de moi, j’ai des potes qui se sont fait manger par la vie. Des fois, c’est légitime, c’est-à-dire qu’ils vont se dire mainstream pour diverses raisons : il faut qu’on mange, on a des familles, etc.
En attendant, je trouve ça plus riche de se dire qu’une culture jeune, qui emprunte ses codes aux jeunes, se doit de conserver cet esprit de “bat les couilles”, car dès l’instant où ça devient calculé, marketé et bien, on perd l’essence de cette culture.
À l’époque, il n’y avait qu’une seule vraie école, celle du graffiti. Aujourd’hui, il y en a peut-être dix fois plus.
Concernant ton propre style, tu nous as parlé de choses radicales, de crade. Est-ce qu’il a évolué ?
Oui, il a évolué. Quand tu entres dans le monde de l’art contemporain et du travail en atelier, en étant issu du graffiti, il faut s’adapter. J’ai remarqué que pour être accepté dans ce milieu, c’est comme si nous devions quitter l’étiquette graffiti pour emprunter celle de l’artiste contemporain et, les codes qui vont avec.
“Dans ma vision, il est important que l’on ressente dans la peinture, l’énergie d’un trait de bombe, de la rue, de la nuit et des trains”
Avant cela, je faisais des lettres bubbles, c’est-à-dire des lettres qui forment des bulles laissant apparaître de la figuration. Je pouvais en faire ce que je voulais, des drapeaux, extincteurs. J’accumule ces lettres dans l’objectif de montrer que l’on pouvait dessiner en utilisant seulement des lettres (essence du graffiti).
Dans ma démarche, je zoome également sur des graffitis. Ça laisse apparaître comme des strates (en archéologie) que l’on peut arracher. Comme si le public pouvait déchirer un mur et y découvrir les différentes couches de strates de tous les graffeur.e.s passé.e.s sur ce mur : du chrome, un lettrage vaporeux, etc.
Je peins d’ailleurs sur du placoplatre, pour que l’on sente la matière de la bombe, je travaille sur des gros blocs, puis je les casse et les remonte ensembles pour que cela raconte plusieurs histoires.
Je m’inspire aussi de graffs qui ne sont pas les miens. Lorsque je me balade dans les rues, je prends parfois en photo certains tags dont la coulure m’a plus. Puis, s’il faut, je vais zoomer sur cette coulure pour la replacer dans un de mes tableaux.
Je m’inspire également des effacements du graffiti, car cela peut laisser presque les mêmes traces que le graffiti. Par exemple, un tag sur un camion, mal effacé à l’acétone. Un gars qui a voulu repasser en bleu mais ce n’était pas le bon bleu et donc ça fait une trace, etc. Cet effacement représente pour moi la dureté qui se trouve derrière la pratique.
Autre situation, avant-hier soir, je suis allé peindre de 00 h à 5 h du matin. Il fait froid, à un moment il faut courir car il y a les flics, tu sautes un grillage, tu t’arraches les mains, il ne faut pas se faire écraser, etc. Tous ces paramètres, doivent pour moi être retranscrit dans la peinture. Elle doit être en ce sens-là, la plus abstraite possible, pour que le public puisse s’imaginer une histoire.
Mon style se concentre sur l’énergie qui émane de la pratique. Je la traduis par l’accumulation de peinture, de couches et le résultat ne sera jamais figuratif ou explicatif. C’est donc ainsi le fond et la forme qui créer le reflet du graffiti, dans sa pureté.
Lors de ma dernière exposition à Marrakech, j’ai entendu le plus beau compliment venant d’une personne qui ne connaissait pas mon travail. Elle m’a dit qu’elle “ressentait beaucoup d’énergie et une certaine violence”.
Ma peinture n’est pas spécialement violente. Je suis d’ailleurs quelqu’un de plutôt cool (rires). Mais il y a cette énergie. De plus, mes toiles sont toujours très grandes (plusieurs mètres de haut) avec des tracés très zoomés. Je pense que, ces éléments les rendent assez immersives. Le public se retrouve un peu à l’intérieur de la matière.
Finalement tes toiles retracent tout ce qu’il s’est passé dans la rue ?
C’est ça, il peut y avoir plusieurs histoires, plusieurs tags, plusieurs effacements.
Dans l’exposition à Marrakech, les photographies que j’expose sont prises de nuit, c’est plus pour recontextualiser l’histoire. Pour que les gens se disent “Ah oui cette culture est aussi une culture nocturne.”
On a également construit une grosse boîte. Le public la traverse et une fois à l’intérieur, il se trouve dans une boîte toute blanche, très aseptisée. L’idée est de faire refléter l’aspect contemporain avec un texte tout simple, faisant le lien entre l’environnement de l’artiste et ses peintures. Mais lorsque l’on rentre pleinement dans la boite (par un trou) il s’agit en fait de la reconstitution d’un squat.
Pour la réalisation de cette œuvre on est allé jusqu’à dépouiller un squat de la région, pour avoir de la vieille laine de verre, des vieux dossiers, des vieilles chiottes, vieux câbles, etc. Nous avons tout démonté, pour donner une impression de chaos.
C’est une démarche intéressante et très aboutit, félicitations ! Tu as pas mal détaillé la place qu’entretenait le graffiti dans la société, mais pour toi quelle serait la place de l’art urbain, et plus précisément celui qui est légal ?
Et bien, pour moi, elle est très délicate, parce qu’elle va dépendre d’où est-ce que l’œuvre se trouve. Je considère que l’on ne va pas mettre de l’art urbain à Mexico, à Tokyo, ou à Hong Kong, comme on peut en mettre à Toulouse. Par exemple des grandes villes comme New York, avant qu’il y ait une overdose de façades peintes, il y a un cap à passer.
“On peut dire qu’il y a des limites au développement de l’art urbain dans chaque ville”
La taille de la ville. Les villes comme Toulouse, plus petites, selon moi il y a une certaine dose d’art urbain à venir y mettre.
Le choix des artistes. Par exemple, si l’on donne les clés d’une ville à un, ou des artistes, qui ont des spectres relativement réduits de l’art urbain, et bien, on va aller vers une catastrophe visuelle. Car nous ne pouvons pas montrer qu’un seul style et ce, qu’il soit figuratif ou abstrait. Il faut représenter la diversité.
Malheureusement, il y a peu de curateurs, de personnes travaillant dans les mairies avec cette notion de la culture urbaine. La place de l’art urbain dans la ville se doit donc d’être réfléchie et assez représentative, là est la difficulté.
Le respect de ce que l’on va recouvrir. Il est important de penser à ce que l’on va recouvrir. Ce n’est pas pareil lorsque le mur est blanc alors on peut y mettre “ce que l’on veut”. Mais s’il y a un graff ou des tags, c’est qu’un gars est venu là pour peindre son truc. Nous ne pouvons pas arriver avec un projet institutionnel et des artistes payés, pour recouvrir d’autres œuvres. Est-ce qu’il n’y aurait pas un souci déontologique ?
Pour l’avoir déjà fait, personnellement, je comprends lorsque des gamins sont mécontents parce qu’on a recouvert son vandale. Après, il faut aussi comprendre que son vandale il l’a fait en quoi, quelques minutes ? Là, on parle d’un travail fait en une semaine, ce n’est pas la même chose. Certaines grosses activités gèrent bien ce genre de conflit, personnellement j’ai du mal.
J’ai encore une grosse partie de mon travail qui se situe dans l’illégalité, et je comprends aussi qu’avec ces fresques, nous anéantissons le patrimoine graffiti de la ville. Patrimoine, qui est peut-être voué à disparaître.
Il y a eu un projet sur la rocade avec 10 graffs de 20 m sur 200 m. La mairie souhaitait endiguer le graffiti situé sur la rocade. Pour cela, ils se sont dits “mettons du graffiti légal” ! Sur le terrain, ils ont appelé des gars du coin, payés 4 000 € par graff, et voilà. Sauf que quelques jours après, il y a eu des gros coups d’extincteurs sur les graffs avec écrit “We love graffiti”. On peut comprendre cette réaction, c’est-à-dire que la rocade est un territoire d’artistes, un lieu où ils peuvent venir peindre gratuitement.
C’est comme si la SNCF décide de peindre tous ses trains. On peut être sûr qu’ils vont tous se faire recouvrir par la suite. Sauf si la SNCF demande à ces mêmes gars de peindre les trains, là ça serait différent. Des histoires de territoires rendent donc la chose plus difficile.
Ce que je reproche aux institutions, c’est de voir la complexité uniquement en deux : il y a du graffiti sale, il y a du street-art. En mélangeant les deux on peut faire quelque chose de propre. Cependant, ça ne peut pas se passer comme ça.
Aujourd’hui, il peut y avoir un artiste spécialiste du graff autorisé, qui se confronte à un artiste spécialiste du graff illégal. Ils ne sont plus de la même famille, de la même école, de la même pratique.
Est-ce que pour toi, il y a des évolutions marquantes dans ce changement ?
Il y a Banksy, il a associé l’art urbain et l’argent. Le problème est qu’il y a des gens qui veulent se faire une place dans l’art urbain en tant qu’artistes de galerie mais en réalité, ils n’ont absolument pas de vision ou de propos artistiques. Ils ont plutôt une vision graphique associée à un business plan.
Je considère que, cela ne peut pas fonctionner car il n’y a pas d’engagement, d’authenticité, de singularité dans un tel travail. Malheureusement, cela rend les œuvres très pauvres.
Si on étudie ou on vit l’art, on peut tout de même remarquer qu’il y a une forme de singularité, un engagement personnel, ou non et une culture ou un mouvement. C’est avant tout un acte honnête.
Il y a ensuite eu la vrille des institutions, qui se sont dit que le street art allait les rendre cools ! (rires)
Rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la place de l’art urbain et du graffiti à Toulouse. Nous prendrons comme terrain, le festival Rose Béton, un projet sous la direction artistique de Tilt.
Échange mené et retranscrit par Jane Vinot et Laura Ribes